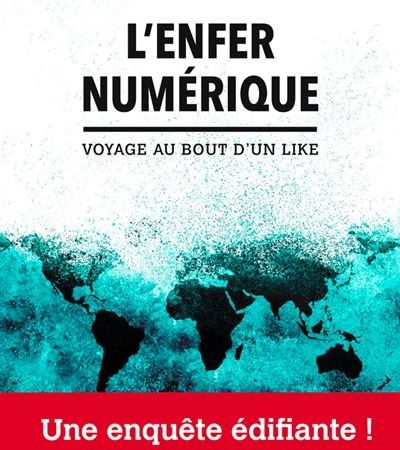Compte rendu de l’ouvrage « L’Enfer numérique », de Guillaume Pitron
Auteur en 2018 de La Guerre des métaux rares, le journaliste français Guillaume Pitron publie en cette fin d’année une nouvelle enquête, cette fois-ci consacrée aux impacts matériels des technologies numériques. Son point de départ est un impensé saisissant : sous ses apparences dématérialisées – dont l’incarnation la plus pure est le cloud, ce nuage duveteux où lévitent nos données – l’industrie du numérique tout entière repose sur de gigantesques infrastructures, au fonctionnement on ne peut plus énergivore. C’est à une description minutieuse de ces infrastructures et de leurs désastreuses conséquences écologiques, le plus souvent soustraites au regard du public, que s’attelle cet ouvrage. En toile de fond, une question de taille se pose : les outils numériques peuvent-ils seulement être mis au service de la préservation de l’environnement ?
Première étape d’un stupéfiant voyage intercontinental, Pitron nous emmène dans la ville de Masdar, aux Émirats arabes unis. Véritable emblème des villes intelligentes, ou smart cities, Masdar se rêve en cité du futur, conciliant durabilité, bien-être et technologie. À l’aide de capteurs de mouvement, de véhicules autonomes et autres installations domotiques [1], il y deviendrait possible de subvenir aux besoins de ses 50’000 futur·e·s habitant·e·s en ayant uniquement recours à des énergies renouvelables, le tout sans produire ni déchets, ni émissions de CO2. Pour autant, le journaliste relève qu’avant 2016, aucune étude scientifique d’envergure ne s’était attachée à déterminer quel était l’impact écologique global d’une telle ville intelligente. Plus troublant encore, d’après les avis de différent·e·s expert·e·s, il apparaît que cet impact pourrait être amplifié – plutôt qu’amoindri – par les technologies déployées dans les smart cities.
Pour comprendre cet apparent paradoxe, Pitron poursuit son voyage en Chine, où sont extraites certaines des matières premières nécessaires à la fabrication des objets numériques les plus communs. C’est dans la province de Heilongjiang, à l’extrême nord-est du pays, qu’est produit le graphite, ce minerai sans lequel smartphones et ordinateurs ne pourraient fonctionner. Les roches extraites des mines sont ensuite acheminées vers des usines, où elles sont plongées dans des bains acides, puis passées dans des fourneaux à haute température. Ce processus de raffinage s’accompagne du rejet de poussières de graphite et autres résidus, aussi néfastes pour les humains que pour l’environnement. Ainsi, l’une des principales causes de la pollution engendrée par le numérique découle « [des] matières premières nécessaires pour fabriquer les 34 milliards de téléphones, tablettes et autres ordinateurs qui circulent aujourd’hui dans le monde. » (p. 58). En effet, malgré le format modeste de nos téléphones les plus modernes, chacun d’entre eux est composé de quelque 50 matières premières différentes – parmi lesquelles l’or, le titane, le baryum ou encore le cobalt. De la même manière, les réseaux de télécommunications et les centres de stockage de données, indispensables au monde du numérique, absorbent une part importante des ressources terrestres : « Impossible, donc, de parler de révolution numérique sans explorer les entrailles de la Terre » (p. 61).
Afin d’appréhender plus concrètement encore le poids de l’industrie numérique, le journaliste poursuit son parcours en Westphalie, dans la ville de Wuppertal, où a été élaborée la méthode de calcul du « material input per service unit » (MIPS). En quelques mots, celle-ci propose de déterminer la quantité totale de ressources incorporées dans le cycle de vie d’un bien ou d’un service. De cette façon, il est possible d’estimer qu’un tee-shirt, de la récolte du coton qui le compose jusqu’à son recyclage, mobilise plus de 200 kilos de matière [2]. Or, il apparaît que plus un objet requiert des technologies de pointe pour être produit, plus son MIPS a tendance à augmenter. Guillaume Pitron explique ainsi qu’une innocente puce électronique est en réalité extrêmement lourde : « 32 kilos de matière pour un circuit intégré de 2 grammes, soit un ratio ahurissant de 16’000/1. » (p. 90). Tout bien considéré, l’intensité matérielle des interfaces et des infrastructures numériques est considérable, quand bien même l’utilisateur·ice final·e du produit n’a aucun moyen de s’en apercevoir.
À ce stade de la lecture, il devient manifeste que les technologies numériques, en raison des matières premières qui permettent leur existence même, ont un impact environnemental considérable. Pour autant, l’auteur met en évidence une seconde source d’impact : le flot de données produites en continu, puis collectées dans des data centers. Ceux-ci sont des lieux de transit, de stockage et de traitement des informations qui s’échangent entre des interfaces ; soit de véritables « usines numériques ». Dès lors, des actions en apparence parfaitement dématérialisées, comme publier une photo en ligne ou échanger des e-mails, engendrent la production et le stockage de quantité de données sur des serveurs dont l’existence est bel et bien physique. Il existe plusieurs millions de data centers, de tailles variées, répartis aux quatre coins de la planète. Le plus grand d’entre eux, établi à Langfang en Chine, occupe une superficie de 600’000 mètres carrés, l’équivalent de 110 terrains de football. Ces chiffres ne sont guère surprenants lorsque l’on réalise que, chaque jour, 5 exaoctets [3] de data sont produits dans le monde, soit « de quoi remplir la mémoire de dix millions de disques Blu-ray qui, empilés, s’élèveraient à quatre fois la hauteur de la tour Eiffel. » (p. 116).
Non contents d’occuper de l’espace, les data centers consomment énormément d’énergie, en particulier de l’électricité. Pitron fait remarquer que « le secteur représenterait à ce jour 2% de la consommation électrique mondiale, un chiffre qui, compte tenu du rythme de la croissance du cloud, pourrait être multiplié par quatre ou cinq d’ici à 2030. » (p. 151). Or, une partie non négligeable de cette électricité est produite à partir de la combustion de charbon, à l’image d’Ashburn, aux Etats-Unis. Dans cette ville, véritable « capitale mondiale du data center », les entreprises du numérique se seraient approvisionnées, entre autres, en électricité produite grâce à du charbon extrait de mines situées dans la région des Appalaches. Des mines qui induisent « une perte notable de biodiversité aux abords des zones exploitées, la disparition de ruisseaux sous l’effet des déplacements de terrain, ainsi que la présence de doses élevées de sélénium dans les ruisseaux alentour. » (p. 160). L’envers de l’immatérialité des technologies du numérique est donc, pour une part, constitué de l’extraction d’hydrocarbures.
Étant donné qu’Internet, pour fonctionner, produit littéralement de la chaleur, une fraction significative de l’électricité dont font usage les data centers contribue à alimenter des systèmes de refroidissement, qui les maintiennent à des températures comprises entre 20°C et 27°C. Pour cette raison, nombre de géants du numérique, soucieux de paraître green, se sont repliés vers des zones à même de refroidir naturellement les data centers, notamment la Laponie suédoise. Le journaliste révèle ainsi qu’en 2013, Facebook a inauguré un nouveau data center à Luleå, à une centaine de kilomètres du cercle arctique, pour y stocker toutes les données produites par ses utilisateurs européens. Loin des regards, la firme californienne étend ses infrastructures, tout en affinant « une stratégie délibérée d’invisibilisation de [sa] présence physique » (p. 184). Cette esthétique de l’immatérialité est soigneusement entretenue par les entreprises du numérique, de manière à poursuivre leurs activités sans que celles-ci ne fassent l’objet de critiques trop virulentes de la part du public.
Par ailleurs, l’architecture matérielle du numérique ne se cantonne pas à la terre ferme, mais sillonne également les profondeurs océaniques. Il s’avère qu’« Internet est un gigantesque réseau amphibie : près de 99% du trafic mondial de données transite aujourd’hui, non par les airs, mais via des courroies déployées sous terre et au fond des mers. » (p. 258). Ainsi, de fins tuyaux de métal, qui renferment en leur cœur des fils de verre, acheminent dans le monde entier les informations numériques à la vitesse de 200’000 kilomètres par seconde. Invisibles car immergés, des centaines de câbles sous-marins s’étendent sur quelque 1,2 million de kilomètres afin de relier numériquement les différentes régions du globe. Si cette infrastructure a un impact direct relativement faible sur les écosystèmes marins, « [sa] dilatation stimule l’expansion de l’univers numérique – et ce que cela suppose de terminaux, de data centers et d’infrastructures énergétiques. » (p. 280). Démultiplier les capacités du numérique conduit, de facto, à approfondir son impact écologique.
*
En définitive, l’ouvrage de Guillaume Pitron permet un éclairage pénétrant des enjeux écologiques qui entourent aujourd’hui les technologies du numérique – ce secteur qui, « compte tenu de sa consommation d’eau, d’énergie, et de sa contribution à l’épuisement des ressources minérales », est désormais responsable « [d’] une empreinte équivalente à deux ou trois fois celle d’un pays comme la Grande-Bretagne ou la France. » (p. 44). Une réalité qui incitera le·a lecteur·ice à porter un regard critique sur l’effarante expansion de l’univers du numérique dans nos vies quotidiennes et sur les conséquences environnementales délétères qui en découlent. Aux portes de l’Enfer numérique, il est sans doute temps de prendre conscience de l’extrême matérialité du virtuel ainsi que des périls vers lesquels il nous entraîne.
[1] La domotique désigne l’ensemble des techniques (électroniques, informatiques, …) utilisées dans les bâtiments pour en contrôler les différents systèmes.
[2] Quand un kilomètre parcouru en voiture « pèse » 1 kilo et une minute passée au téléphone 200 grammes.
[3] Un exaoctet équivaut à un milliard de milliard d’octets.
Sources et liens utiles
Guillaume Pitron (2021), L’Enfer numérique : voyage au bout d’un like, Éditions Les Liens Qui Libèrent, 352 pages.
Passage de Guillaume Pitron dans une émission radio de France Culture, le 27 octobre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=PjNl5EfWE4A
Thibaud