Compte rendu de l’ouvrage « Bullshit jobs », de David Graeber
Et si une importante partie de nos jobs ne servait tout simplement à rien…
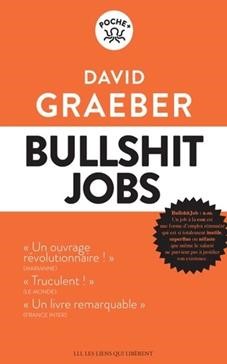
Anthropologue américain de renom, aujourd’hui disparu, David Graeber publiait en 2018 un ouvrage au titre étonnant : Bullshit jobs, expression qui peut être traduite en français par « Jobs à la con ». En observateur avisé de la multiplication des emplois aux contours nébuleux – parmi lesquels les consultants en ressources humaines, les stratégistes financiers et autres conseillers techniques – Graeber posait en introduction de son livre la double question suivante : « et si ces jobs étaient réellement inutiles ? Et si ceux qui les occupent en étaient conscients ? » (p. 7). Dans ce compte rendu, je me propose d’exposer, d’une part, la définition des bullshit jobs que donne l’anthropologue et, d’autre part, la typologie qu’il dresse des différents types de bullshit jobs existants ainsi que leur raison d’être.
En s’appuyant sur les nombreux témoignages qui lui ont été envoyés par des internautes, Graeber définit le job à la con comme « une forme d’emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu’il n’en est rien. » (p. 39). Partant, le job à la con par excellence est celui qui, du jour au lendemain, pourrait tout bonnement disparaître sans que la marche du monde en soit affectée, ni que quiconque ne s’en rende compte. Autrement dit, il s’agit d’un job dont la valeur sociale est nulle, et ce de l’avis même de la personne qui l’occupe [1]. Ce phénomène pourrait sembler anecdotique, à la manière d’une simple bizarrerie ou d’une anomalie statistique se déployant dans les marges du monde du travail moderne. Or, si l’on en croit Graeber, non seulement une importante partie des emplois sont aujourd’hui des jobs à la con, mais de surcroît de plus en plus d’emplois le deviennent – ce qui amène l’auteur à évoquer un véritable processus de « bullshitisation de l’économie » [2]. Et cette évolution est lourde de conséquences : « Nous pourrions parfaitement devenir des sociétés de loisir et instaurer des semaines de travail de vingt heures. Peut-être même de quinze. Au lieu de cela, nous nous retrouvons collectivement condamnés à passer la majeure partie de notre vie éveillée au travail, à exécuter des tâches qui, nous le savons bien, n’ont aucun impact significatif sur le monde. » (p. 64).
Quels sont donc ces jobs qui n’ont aucune utilité ? Graeber en distingue 5 grandes catégories :
1/ Les larbins. Ceux-ci « ont pour seul but – ou pour but premier – de permettre à quelqu’un d’autre de paraître ou de se sentir important. » (p. 67). Équivalents modernes des laquais féodaux, peu importe le contenu ou la nature des emplois qu’occupent les larbins : il s’agit de signaler le statut symbolique supérieur des personnes ou des organisations dont ils sont tributaires – à l’image des assistants administratifs désœuvrés dont s’entourent les responsables de certaines firmes ou des portiers embusqués à l’entrée d’hôtels prestigieux.
2/ Les porte-flingue. Il s’agit ici de personnes « dont le boulot non seulement comporte une composante agressive, mais surtout – c’est fondamental – n’existe que parce qu’il a été créé par d’autres. » (p. 79). Ainsi des forces armées, uniquement nécessaires parce que les États voisins en sont eux-mêmes dotés ; une logique que Graeber prolonge aux lobbyistes, experts en relation publique et autres télémarketeurs. Une dimension significative de ces jobs consiste par ailleurs à manipuler, si ce n’est carrément tromper, les publics visés – de façon à leur vendre un bien ou un service dont ils n’ont aucunement le besoin.
3/ Les rafistoleurs. Ce sont les personnes « dont le job n’a d’autre raison d’être que les pépins ou anomalies qui enrayent une organisation – en somme, ils sont là pour régler des problèmes qui ne devraient pas exister. » (p. 85). Autrement dit, si ces emplois sont créés, c’est quasi uniquement en raison de bugs jamais corrigés ou d’erreurs commises par un·e supérieur·e incompétent·e – autant de disfonctionnements qui doivent par la suite être rectifiés par des subalternes. Cette situation est celle où un système est « conçu de manière si stupide que le plantage est assuré, mais que, au lieu de réparer la cause, on préfère embaucher des gens dont le boulot consistera en tout ou en partie à gérer les dégâts. » (p. 90).
4/ Les cocheurs de cases. Ces jobs-là ont pour « seule ou principale raison d’être […] de permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu’en réalité elle ne fait pas. » (p. 92). Ces véritables emplois écrans, à l’instar de nombreux consultants et experts en tous genres, produisent des rapports ou des audits, des enquêtes de satisfaction, des normes de service, des statistiques internes, … Autant de documents qui permettent ensuite aux entreprises dont ils émanent de se féliciter des mesures (supposément) mises en place.
5/ Les petits chefs. Ils se subdivisent en deux catégories : les premiers « se contentent d’assigner des tâches à d’autres. » (p. 101), alors que les subalternes sous leurs ordres pourraient parfaitement se débrouiller sans eux ; tandis que les seconds sont essentiellement occupés « à générer des tâches à la con qu’ils confient à d’autres, à les superviser, ou même à créer de toutes pièces de nouveaux jobs à la con. » (ibid). Cette dernière catégorie de bullshit jobs est à minima inutile, voire carrément nuisible puisqu’elle participe dans certains cas à « bullshitiser » la vie des autres travailleurs jusque-là épargnés.
Au-delà de cette typologie qui prête à sourire, David Graeber explore dans le reste de son ouvrage les causes historiques et sociales qui permettent d’expliquer l’actuelle prolifération des bullshits jobs et le bien peu de réactions que celle-ci entraîne. Selon lui, cette situation résulte de l’essor, à partir des années 1970, du capitalisme financier et plus particulièrement du secteur FIRE (finance, assurance, immobilier). Ce dernier est parvenu à s’accaparer la part du lion des gains de productivité, dont « une bonne partie est allée grossir la fortune du 1% le plus riche – les investisseurs, les dirigeants et les échelons les plus élevés de la classe des professions intellectuelles et cadres sup. » (pp. 274-275). Dans le même temps, « une part considérable de ces bénéfices a aussi servi à créer des emplois dans cette catégorie des professions intellectuelles et cadres sup. Il s’agit de ces postes inventés de toutes pièces, fondamentalement inutiles et généralement flanqués d’une armée de petites mains administratives tout aussi inutiles » (p. 275). En somme, les jobs à la con sont la résultante d’une lente évolution structurelle, qui s’est traduite par l’instauration d’une forme de féodalité managériale « dans laquelle les richesses et les positions sont allouées pour des motifs non pas économiques, mais politiques » (ibid).
Véritable pépite, ce livre offre une perspective tout à la fois drolatique et consternante des travers de notre société contemporaine, obnubilée par le culte du travail. Malgré la noirceur du tableau dépeint par Graeber – les jobs à la con entraînant à la longue de profondes séquelles physiques et morales pour les personnes qui les exercent – le·a lecteur·ice ressort du livre optimiste, puisque l’auteur rappelle au fil des pages que cet état de fait n’a rien d’une fatalité. « Au cours des millénaires, rappelle l’anthropologue, d’innombrables groupes humains […] ont réussi à distribuer les tâches nécessaires à leur survie et au maintien de leur style de vie de telle manière que tous leurs membres, ou presque, pouvaient apporter leur contribution, et en tout cas que personne ne se retrouvait à passer l’essentiel de ses journées à faire quelque chose qui lui déplaisait, comme c’est le cas de nos jours. » (p. 403). À certains égards, il ne tient qu’à nous de créer collectivement un monde désirable, débarrassé de ses bullshit jobs qui nuisent autant aux humains qu’à l’environnement. Tout en se gardant de promulguer des « solutions toutes faites », Graeber propose, d’un côté, de réduire massivement le nombre d’heures de travail hebdomadaires et de mieux répartir le travail réellement productif restant. De l’autre côté, il explore le principe du revenu universel de base, lequel permet de décorréler radicalement la garantie des moyens d’existence et l’exercice d’une activité rémunérée. Des pistes de réponse qu’il conviendrait aujourd’hui d’explorer sérieusement, tant l’urgence climatique et sociale est grande. En définitive, si le métier d’anthropologue n’a rien d’un bullshit job, c’est précisément en ce qu’il permet de remettre en cause nos pratiques et nos comportements quotidiens, des plus anodins aux plus absurdes.
Pour clore définitivement cet article, voici, en vrac, quelques extraits de témoignages mis en avant par David Graeber dans son livre.
« Judy : Le seul job à plein temps que j’aie jamais eu était inutile de bout en bout. C’était dans une boîte d’ingénieurs privée, aux ressources humaines. Je ne me trouvais là que parce que le Grand Chef des RH était une feignasse qui ne décollait jamais les fesses de son fauteuil. J’étais assistante RH. Mon boulot me prenait – c’est pas des conneries – une heure, une heure et demie par jour à tout casser. Le reste, c’est-à-dire sept heures et des poussières, je le passais à jouer au 2048 ou à regarder YouTube. Le téléphone ne sonnait jamais. Il ne me fallait pas plus de cinq minutes pour rentrer les données dans l’ordi. J’étais payée à m’emmerder. Mon patron aurait facilement pu faire mon boulot, mais je vous dis – c’était un sale con feignant. » (p. 77)
*
« Magda : Une fois j’ai travaillé dans une PME comme « testeuse ». J’étais chargée de relire et corriger les rapports écrits par leur chercheur/statisticien star. C’était un snob qui ne connaissait que dalle en statistiques et était incapable de pondre une phrase grammaticalement correcte. Il s’appliquait à éviter tout recours aux verbes. Sa prose était tellement nulle que j’avais décidé de m’offrir un petit gâteau si je tombais sur un seul paragraphe cohérent. J’ai perdu 6 kilos en bossant dans cette boîte. Pour chacun de ses rapports, mon job était d’essayer de le convaincre d’entreprendre une refonte totale du texte. Évidemment, il n’acceptait jamais de changer la moindre virgule, et encore moins de retravailler l’ensemble, donc je finissais par soumettre le truc tel quel aux directeurs. Ils étaient tout aussi illettrés que lui en matière de statistiques, mais, comme c’étaient des chefs, ils pouvaient faire traîner les choses plus longtemps. » (p. 87)
*
« Ben : J’occupe un job à la con dans le management intermédiaire. J’ai dix personnes qui travaillent pour moi, mais pour autant que je puisse en juger, toutes sont capables de faire le boulot sans qu’on les surveille. Mon seul rôle, c’est de leur distribuer les tâches – notez que ceux qui conçoivent ces tâches pourraient parfaitement les leur confier directement. (J’ajouterais que, bien souvent, les tâches en question sont produites par des managers qui ont eux-mêmes des jobs à la con ; du coup, j’ai un job à la con à double titre). » (p. 102)
*
« Finn : Mon job c’est chef du support technique dans une société de software as a service. Cela consiste essentiellement à participer à des réunions, envoyer des mails, informer mon équipe des changements à venir, faire remonter les problèmes rencontrés par les clients et rédiger les évaluations de performance […] Si en me pointant lundi je découvrais que l’immeuble avait disparu, non seulement le monde entier s’en ficherait éperdument, mais moi aussi. La seule satisfaction que je tire de mon boulot, c’est peut-être d’avoir développé une expertise pour naviguer au sein de notre organisation dysfonctionnelle et d’être dur à la tâche. Mais devenir expert de quelque chose d’inutile, ce n’est pas très gratifiant » (p. 198)
[1] Graeber distingue les jobs à la con des « jobs de merde » : si les premiers ne servent tout simplement à rien et sont parfois nuisibles ; les seconds sont bénéfiques à la société, mais les personnes qui les occupent sont souvent mal rémunérées et déconsidérées.
[2] Ainsi, une enquête réalisée au Royaume-Uni par l’institut de sondage YouGov, en 2015, demandait aux répondants si leur emploi contribuait utilement à la société (Is your job making a meaningful contribution to the world ?) : 50% des réponses étaient positives, 13% indécises et 37% négatives. Il ne s’agit donc pas, dans la société britannique, d’un phénomène purement marginal.
David Graeber (2019, 2018 pour la version anglaise), Bullshit jobs, Éditions Les Liens Qui Libèrent, 448 pages.
Thibaud
